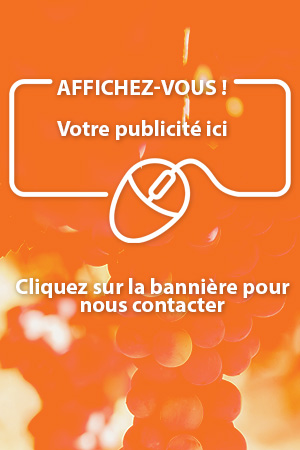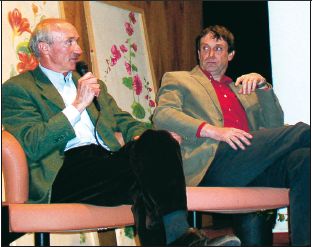 Message de bienvenue sur l’écran, atmosphère électrique dans les travées de la Salamandre. A 17 h 30, ce mardi 20 mars, un léger climat d’excitation flottait sur les nombreuses têtes chenues qui avaient pris place un peu avant l’heure et les plus jeunes qui arrivaient par grappes. Etait-ce le public plus éclectique qu’à l’ordinaire ? Etait-ce la présence d’une poignée de fringants quadras ressemblant plus à des banquiers qu’à des viticulteurs ? Ou l’effet de l’animateur chevronné qui grimpait sur scène ? Bref, l’heure était piquante. Et somme toute, la réunion tint ses promesses. Pas de lassitude, un rythme soutenu, une impeccable présentation « power point » dopée par les commentaires de deux jeunes intervenants, une parole savamment distribuée, un débat d’où l’esprit de polémique fut la plupart du temps absent (à une ou deux entorses près). Un travail de pros. Et l’information dans tout cela ? Comme toujours, il resta pas mal de cadavres dans le placard mais quelques-uns parvinrent tout de même à sortir, au détour d’une question, d’une réaction de la salle, d’un coup de gueule ou d’une verte réplique. Si, parmi les 250 auditeurs, une partie était manifestement acquise aux thèses du syndicat, une autre était véritablement venue s’informer. Elle est repartie sinon rassérénée, du moins lestée d’un éclairage supplémentaire.
Message de bienvenue sur l’écran, atmosphère électrique dans les travées de la Salamandre. A 17 h 30, ce mardi 20 mars, un léger climat d’excitation flottait sur les nombreuses têtes chenues qui avaient pris place un peu avant l’heure et les plus jeunes qui arrivaient par grappes. Etait-ce le public plus éclectique qu’à l’ordinaire ? Etait-ce la présence d’une poignée de fringants quadras ressemblant plus à des banquiers qu’à des viticulteurs ? Ou l’effet de l’animateur chevronné qui grimpait sur scène ? Bref, l’heure était piquante. Et somme toute, la réunion tint ses promesses. Pas de lassitude, un rythme soutenu, une impeccable présentation « power point » dopée par les commentaires de deux jeunes intervenants, une parole savamment distribuée, un débat d’où l’esprit de polémique fut la plupart du temps absent (à une ou deux entorses près). Un travail de pros. Et l’information dans tout cela ? Comme toujours, il resta pas mal de cadavres dans le placard mais quelques-uns parvinrent tout de même à sortir, au détour d’une question, d’une réaction de la salle, d’un coup de gueule ou d’une verte réplique. Si, parmi les 250 auditeurs, une partie était manifestement acquise aux thèses du syndicat, une autre était véritablement venue s’informer. Elle est repartie sinon rassérénée, du moins lestée d’un éclairage supplémentaire.


modification des décrets d’appellation
Un point apparemment sensible fut soulevé quand affleura le sujet de la modification des décrets d’appellation de 1936 et 1938. Rappelons que cette modification se justifie par l’introduction du système d’affectation parcellaire et, avec lui, la gestion des vignes Cognac par l’INAO. D’où la nécessité d’un « toilettage » sur les conditions de production notamment. Furent appelés à s’exprimer Jean-Marc Girardeau et Bernard Gauthier. Le premier, ancien juriste du BNIC, actuel secrétaire général de la maison Camus, capta l’intérêt de la salle quand il avoua son inquiétude. « Ce n’est pas une question de défiance envers les personnes chargées du dossier mais ce texte constitue en quelque sorte notre patrimoine depuis plus de 70 ans. Toute la jurisprudence s’inspire de lui. Quels que soient les pays, quelles que soient les appellations, un décret d’AOC a une fonction prééminente, celle de protection et, très partiellement, une fonction d’organisation économique. Le décret Cognac représente notre carte d’identité commune. C’est pour cela que les options prises m’inquiètent. Je les trouve en grande partie inadéquates. » Propos dans la lignée desquels s’est inscrit Bernard Gauthier, ancien président du CRINAO, viticulteur à Malaville. « Si le décret avait été si mauvais, depuis 70 ans, cela ce serait su. Pour faire un produit de qualité comme le Cognac, nous n’avons pas eu besoin de modifier les conditions de production. Depuis le départ, les interprofessions du Cognac et du Champagne furent aux avant-postes de la défense des appellations. Le Bureau national du Cognac a toujours montré ce dont il était capable en la matière. Faisons très attention à ne pas laisser partir cet outil de défense en le remettant entre les mains des fonctionnaires de l’INAO. Quelle que soit leur efficacité, c’est toujours un peu différent. S’il nous faut modifier les décrets de 36 et 38, prenons garde. Soyons très vigilants ! »
les conséquences de l’affectation
Avec le 3e thème de la soirée – intitulé « les conséquences finales de la seule voie imposée, l’affectation parcellaire » – les organisateurs de la table ronde commencèrent à « taper dans le dur ». Parmi le public, certains n’étaient sans doute venus que pour cette partie. Chiffres du BN à l’appui, la démonstration fut rapidement troussée : aujourd’hui, la viticulture charentaise n’atteint pas le seuil de rentabilité de 6 585 € de l’ha et elle l’atteindra encore moins en système d’affectation. Premier à s’exprimer, Olivier Louvet, l’un des piliers du SVBC, déplora « que, dans cette réforme, l’on ne s’occupe pas tellement du revenu des viticulteurs mais que l’on s’évertue surtout à faire rentrer un système dans les tuyaux, à charge 

Vous avez dit « responsable », « solidaire » ! En Charentes, c’est un fait, ces termes ressemblent presque à des gros mots. Ils suscitent en vrac sourires narquois, ironie, scepticisme. Ils font passer ceux qui les tiennent pour de francs naïfs ou de gentils demeurés. C’est ainsi que la grosse caisse des « vrais réalistes » a donné de la voix, parfois sur le mode un peu poisseux de la connivence. « Bernard, peut-être affecteras-tu quelques ha à autre chose qu’au Cognac parce que tu fais partie du syndicat. Mais tu sais bien que tout le monde dans cette région va tout affecter au Cognac. Automatiquement, l’année suivante, la QNV va chuter, entraînant la hausse du prix des comptes jeunes. Dans les deux ans, les ventes de VS se casseront la figure et la crise sera de nouveau là. Ne nous engageons pas sans réfléchir dans ce système. » Applaudissements de la salle. Quelqu’un qui plaidait pour la « valeur ajoutée » attachée à une meilleure définition des vignes Cognac s’est attiré la réplique suivante : « A 6 de pur, elle sera où ta valeur ajoutée ! » L’expression des réactions « tripales » se poursuivit, en un long exutoire. « Cela me fait mal au ventre de voir que nos chiffres d’affaires s’améliorent et que l’on va tout fiche par terre en pensant que les gens se montreront solidaires. Mais non ! Ce sera le chacun pour soi et on en reprendra pour dix ans ! » « Si les viticulteurs étaient raisonnables, cela se saurait ! » s’est exclamé un autre qui lui aussi a convoqué le spectre des dix prochaines années de crise. Un témoignage pourtant apporta un contrepoint à ces réactions éruptives. Ce fut celui de Jean-Marie Ordonneau, expert-comptable, associé du cabinet ACL. Il a d’abord cautionné le montant des coûts de production, de 5 700 € de l’ha. « A 200 € près, nous nous retrouvons tous sur ce chiffre, experts-comptables, centres d’économie rurale. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un seuil de rentabilité et que le viticulteur, en couvrant ce chiffre, n’a pas encore gagné d’argent. N’oublions pas non plus qu’en dix ans, dans cette région, les gains de productivité ont allégé les charges de 10 à 15 %, une performance assez unique qui ne se renouvellera pas. Nous sommes au taquet. Les coûts de production ne descendront pas et, vraisemblablement, ils monteront même un peu, sous le coup des obligations réglementaires. Sans faire de surenchère, il ne me paraîtrait pas scandaleux qu’un viticulteur, en vendant du vin Cognac, puisse dégager un chiffre d’affaires de 6 500 € par ha, ce qui lui laisserait une marge de rentabilité de 10 à 15 %. Je comprends que l’on s’oppose sur des systèmes d’organisation mais a-t-on suffisamment réfléchi aux modèles qui permettraient d’obtenir un chiffre d’affaires de 6 500 € de l’ha ? Evidemment, au cours de ces deux dernières campagnes, le Cognac va mieux mais il faut absolument avoir en tête un modèle pérenne pour les viticulteurs d’aujourd’hui et ceux de demain. » Applaudissements nourris de l’auditoire, signe qu’en déplaçant le raisonnement, l’intervenant avait peut-être touché du doigt les vrais enjeux. La salle ne s’y est pas trompée.
Plus chahutée fut la contribution de Philippe Sabouraud. Ce dernier se livra à une charge contre le comité permanent du BNIC, « composé de gens au demeurant dynamiques, ouverts et entrepreneurs mais qui, une fois franchis le seuil de l’interprofession, se voient affligés d’une toile d’araignée sur la tête et qui, collectivement, deviennent minables ». « Le résultat de l’interprofession sur dix ans ? Une QNV à 6 de pur pendant 7 ans, des chiffres d’affaire insuffisants, la perte de 2 500 exploitants, la transformation de l’exploitation familiale en exploitation de la famille, introduisant une distorsion de concurrence entre les structures. Un échec économique ! » « A ce train, on ne risque pas de délocaliser » a-t-il raillé avant de rappeler qu’il avait démissionné du comité permanent pour ne pas être « complice » de tels agissements. Ramené au thème du débat par le « modérateur », le viticulteur de Mérignac a indiqué qu’en économie il existait un système clé : « Pour que les prix montent, il faut que le potentiel de production soit un peu inférieur aux besoins et, quand je dis cela, je ne parle pas de la capacité de production qui, elle, doit alimenter le marché. »
La diatribe de l’orateur ne pouvait rester lettre morte. Jean-Luc Lassoudière lui a répondu que si la région avait écouté ses calculs cartésiens, elle aurait arraché 30 000 ha. « Où en serait-on à présent ? » Mais la réaction la plus violente vint de Jean-Bernard de Larquier. Pourtant, les choses avaient commencé assez benoîtement. Appelé avec d’autres à s’exprimer en fin de réunion comme « grand témoin », le président du SGV assura que les positions n’étaient pas fermées. « Nous allons continuer d’échanger. » De même il salua l’intervention de B. Gauthier en faveur de la défense de l’appellation. « Je n’en attendais pas moins de lui. » Pourtant le ton monta crescendo quand il annonça très clairement qu’il ne serait pas le professionnel qui cautionnerait une structure juridique intenable. Et éclata carrément pour fustiger celui qui avait démissionné du comité permanent. « Pour moi, le courage syndical consiste à assumer ses décisions, en les respectant et non en les bafouant comme vous l’avez fait en ne respectant pas la QNV. Il y a des tribunaux pour cela. » Ouah ! Silence dans les rangs. Sur sa lancée, le syndicaliste indiqua « que si le négoce pouvait aujourd’hui engranger des bénéfices, c’était aussi grâce à la viticulture qui s’était saignée aux quatre veines pour porter le stock quand le Cognac marchait mal. Il faudra que cette vérité soit entendue. » En toute fin de réunion, Bernard Gauthier fit passer un message subliminal sur « les vins destinés au Cognac qui, dans un système INAO, pourraient être considérés comme autre chose que des vins de bouche et s’attireraient donc un traitement à part ». Peut-être était-ce pour répondre à la question posée en toute dernière minute par une jeune femme : « Le SVBC peut-il nous dire quel est son projet ? »
En conclusion, Christophe Véral a demandé de la souplesse et de la réactivité pour ceux qui voulaient vivre de leur produit encore longtemps. « Le combat ne fait que commencer. » A la sortie, le SVBC distribuait des tacts réclamant un référendum « afin que chaque viticulteur ou entité qui cotise au BNIC puisse choisir son avenir et non le subir ».