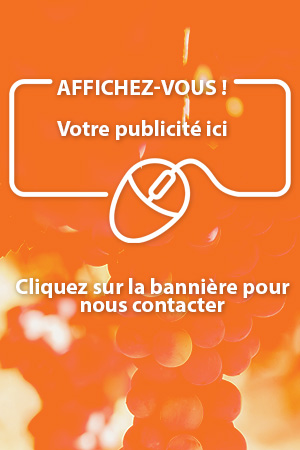Maîtrise des volumes (accord sur la QNV de 6 de pur ha), affectation et extournement des surfaces pour préserver les autres débouchés et donner plus de souplesse à la production Cognac, sensibilité à l’occupation du territoire… Didier Braud et Jean-Marie Arrivé, respectivement présidents du SVC (Syndicat des viticulteurs charentais) et de la commission viticole de la Chambre d’agriculture 17, ont exposé la vision 17 du vignoble charentais devant environ 350 viticulteurs réunis à Saintes le 30 juillet dernier.
Maîtrise des volumes (accord sur la QNV de 6 de pur ha), affectation et extournement des surfaces pour préserver les autres débouchés et donner plus de souplesse à la production Cognac, sensibilité à l’occupation du territoire… Didier Braud et Jean-Marie Arrivé, respectivement présidents du SVC (Syndicat des viticulteurs charentais) et de la commission viticole de la Chambre d’agriculture 17, ont exposé la vision 17 du vignoble charentais devant environ 350 viticulteurs réunis à Saintes le 30 juillet dernier.
Né en partie du Prav, travaillé conjointement par les commissions viticoles des Chambres d’agriculture 16-17 et par la FRSEA, « ce schéma résulte d’une réflexion partagée » ont indiqué les deux animateurs. Invité, Philippe Boujut, président du SGV Cognac, est intervenu en fin de matinée comme Jacques Maroteix, président de la Chambre d’agriculture 17. Alain Lebret, son homologue charentais, était absent mais pour des raisons indépendantes de sa volonté. Objet de la réflexion, présenté par J.-M. Arrivé : « organiser la viticulture en maîtrisant la production pour assurer un revenu au viticulteur tout en conservant nos jolis paysages ! » En ressort d’emblée ce qui fait un peu la « Charente-Maritime touch » : renforcement du pouvoir du viticulteur dans la gestion de sa production ; sensibilité à la dimension territoriale pour éviter, autant que faire se peut, qu’une trop forte érosion des surfaces viticoles dans certains secteurs crée des poches de désertification, sans oublier la pérennité de l’outil de travail et sa transmission aux générations à venir. Pour les formations syndicales et professionnelles réunies le 30 juillet à Saintes, le Schéma d’avenir du vignoble charentais représente « la clé de voûte de la nouvelle organisation ».


Une affectation obligatoire.
Par extournement, les promoteurs du projet entendent la possibilité de report de production sur les moûts Pineau, vin de table, vin de pays, sans exclure bien sûr la reconversion en cépages autres ou l’arrachage. La proposition n’a pas manqué de soulever des réactions dans la salle. « En montant le quota à 8 de pur, vous vous partagez le gâteau et vous nous laissez les miettes ! » Ou encore : « 8 hl à 17 F, c’est toujours mieux que 6 à 17. C’est ça que vous voulez ! »
Didier Braud s’est attaché à expliquer que « 80 000 ha à 6 ou 60 000 ha à 8, cela ne changeait rien au potentiel global de production Cognac, qui restait toujours le même ». Même chose au niveau individuel : « Une exploitation de 10 ha aura toujours 60 hl AP de QNV (10 ha x 6 hl AP/ha). Cela ne modifiera en rien ses courants commerciaux. Seule la ventilation sur les ha s’en trouvera changée. » J.-M. Arrivé ne le nie pas : « Ce qui est présenté là n’est pas la résolution de la crise demain. C’est une façon de pérenniser le vignoble, un schéma adaptable sur toutes les exploitations Cognac, ménageant l’ensemble des débouchés actuels. On ne peut pas empêcher le négoce d’acheter là où il veut mais si la production est maîtrisée, il devra bien aller là où est le produit. » Pour le président de la Chambre d’agriculture 17, Jacques Maroteix, les enjeux de maîtrise de la production sont fondamentaux. « Ce n’est pas le moment de lâcher prise. Il faut que la viticulture se réapproprie un peu de pouvoir. Les viticulteurs doivent discuter entre eux. Le rôle du SGV Cognac est à cet égard très important. » De même la tenue d’un seul discours et d’un discours clair pour l’ensemble de la région, à Paris comme à Bruxelles, lui semble incontournable. « Vous viticulteurs, vous êtes à un virage important et vous avez raison de vouloir maîtriser votre production.
Les jalons du passé
Dans un parcours, quel qu’il soit, il n’est jamais vain de jeter un regard en arrière pour retrouver quelques jalons du passé. En survolant quarante années de viticulture charentaise, J.-M. Arrivé a réveillé les mémoires.
« Le vignoble charentais, a-t-il dit, c’est aujourd’hui 80 560 ha, 7 100 viticulteurs. Le stock de Cognac s’élève à 3,2 millions d’hl AP et les sorties à 397 000 hl AP. L’évaporation du stock est de 60 000 hl AP par an. De 60 à 74, le vignoble, très disparate dans son encépagement, connaît des à-coups comme la gelée de 1956 ou différents épisodes mildiou. Les rendements sont faibles, de 5 à 6 hl AP/ha. C’est l’époque où tout le monde veut planter, de la grand-mère au petit-fils. De 70 à 80, les viticulteurs se montrent très réactifs, ils investissent dans les techniques nouvelles, la production ha est multipliée par 2,6, le stock grimpe, les cours s’effondrent. Les aides européennes soutiennent le marché des vins de table. De 1980 à 1987, la première restructuration du vignoble est boostée par l’embellie céréalière, qui rend les choses plus faciles. En même temps, les ventes augmentent et le stock diminue à 6,5 années de ventes. Le négoce élargit son territoire d’achat. Les années 88-90 marquent une époque très libérale. Le niveau de stock, faible, fait monter les prix et les viticulteurs font de la rétention. Déjà, on évoque le risque de manquer de produit. Les viticulteurs les plus entreprenants investissent à tout va dans le matériel, le vignoble. Une fiscalité inadaptée capte une partie du pactole tiré des ventes. Viennent deux années de distillation pléthorique ! Les verrous sont lâchés. On délaisse le marché des vins de table. De 1991 à 1997, le réveil sera douloureux. La gelée de 1991 débouche sur un constat amer : la région est endettée, on a produit trop d’eaux-de-vie. Il faudra attendre 1997 pour que la décision des 6 de pur ha soit prise, dans la douleur mais prise tout de même et l’on ne peut que constater la sagesse d’une telle mesure. En 1999/-2001, le plan de restructuration voit le jour, prônant la réduction du vignoble mais le cœur n’y est pas. Les trésoreries sont au plus bas, les banques frileuses, la PAC inquiétante. La viticulture charentaise veut encore croire au Cognac. 2001-2002 : le paysage économique a changé. Les responsables professionnels échafaudent un schéma qui sauve à la fois le Cognac et les autres débouchés, une solution porteuse d’avenir et réaliste. »