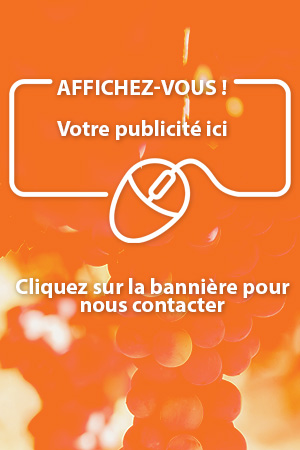Faut-il opposer installation et agrandissement ? Sans doute pas et la réalité le prouve tous les jours. Les deux peuvent cohabiter. Pourtant les risques de dérives existent. La profession réfléchit à des contre-feux au tout agrandissement.
Personne ne l’ignore. Les chiffres de l’installation ne sont pas bons, en Charente comme en Charente-Maritime. Dans ce département, l’année 2003 se sera conclue par le dépôt de seulement une soixantaine de dossiers d’aide à l’installation, tous secteurs confondus, un bien faible score par rapport au potentiel agricole existant. Mais la Charente-Maritime « plafonne » à ce niveau depuis des années, sans vraiment parvenir à décoller. En cela, elle ne fait ni mieux ni pire que les autres départements français. Elle se situe dans la mouvance nationale. A regarder la partie viticole, la performance apparaît encore plus navrante. Il n’y aurait eu l’an dernier que 9 dossiers d’installation viticole (à peu près le même nombre en Charente). Cependant, avant d’être soumis à interprétation, tout chiffre gagne à être mis en perspective, ce que ne manque pas de faire Philippe Chatellier, conseiller installation à l’ADASEA 17. A côté des installations aidées, il convient de ne pas oublier les installations non aidées, estimées à 30 ou 35 % du chiffre total. Par ailleurs, la classification des exploitations par OTEX (orientations technico-économiques) éloigne de la catégorie viticole des exploitations de 15 à 20 ha de vignes, du simple fait de la présence de céréales à côté. Ces éléments mis bout à bout, sans redresser de façon spectaculaire les chiffres d’installations viticoles, les relativisent quelque peu. Le conseiller installation estime que même si le déficit existe, il est peut-être moins important qu’à première vue. En terme d’installation, les ateliers lait et vigne arrivent malgré tout en tête dans le département littoral charentais, devant le secteur céréalier. L’inquiétude naîtrait davantage du futur proche – dans les 5-10 ans – quand, sous l’effet de la pyramide des âges, la génération de l’après-guerre partira à la retraite. On annonce alors la libération de plusieurs dizaines de milliers d’ha. En zone viticole, la question des petites structures de moins de 5 ha de vignes va cristalliser le phénomène. Que vont devenir ces structures non viables en tant que telles ? Iront-elles obligatoirement nourrir l’agrandissement ou peut-on parier sur un regroupement d’exploitations, « trois exploitations non viables pouvant constituer une exploitation viable » ?
Le jeune « porteur d’agrandissement »
 Certes, agrandissement et installation ne sont pas antinomiques. D’ailleurs, rares sont les installations à ne pas être consolidées par un agrandissement. Dans un projet, le jeune est souvent « porteur d’agrandissement » et les jeunes ne sont pas toujours les derniers à nourrir la pression foncière. Par contre, devant la déferlante annoncée de l’offre foncière, la profession craint la perte des grands équilibres ; que, faute de candidats potentiels à l’installation, trop d’ha se retrouvent aspirés par l’agrandissement au détriment de l’installation. On risquerait alors d’assister à la constitution de fiefs inexpugnables, qui colorerait de façon radicalement différente le paysage. Question du jour : « Vaut-il mieux avoir un voisin ou s’agrandir ? ». C’est pour cela qu’au plan national comme dans les régions, l’installation fait plus que jamais office de cheval de bataille, même si certains ne sont pas sans dénoncer le côté un peu « Dr Jekyl et Mister Hyde » du discours agricole sur le sujet. Les jeunes agriculteurs des CDJA 16 et 17 parlent de l’acte « citoyen » qui consisterait à transmettre à un jeune plutôt qu’au plus offrant. Ils n’ignorent rien du caractère peu incitatif du fermage ni de la location « qui conduit à la vente ». S’inspirant des réflexions du CNJA, ils se demandent si des réserves foncières ne pourraient pas voir le jour sous l’égide de collectivités locales, telles les communautés de communes. Même tonalité chez le président du syndicat viticole de la Confédération paysanne 17, Bernard Bégaud qui, comme il existe des ateliers relais ou des magasins relais, propose la création d’exploitations relais. « A l’heure de la retraite, il paraît légitime que les gens puissent vendre leurs vignes pour retrouver un peu de “bonheur économique”. Ne pourrait-on pas créer un organisme du type “conservatoire du territoire” qui achèterait le capital foncier et louerait cet outil de travail aux jeunes ? » Lui aussi stigmatise « le double langage » autour de l’installation. « Il n’y a pas de volonté politique pour permettre aux jeunes de s’installer dans le cadre du fermage. »
Certes, agrandissement et installation ne sont pas antinomiques. D’ailleurs, rares sont les installations à ne pas être consolidées par un agrandissement. Dans un projet, le jeune est souvent « porteur d’agrandissement » et les jeunes ne sont pas toujours les derniers à nourrir la pression foncière. Par contre, devant la déferlante annoncée de l’offre foncière, la profession craint la perte des grands équilibres ; que, faute de candidats potentiels à l’installation, trop d’ha se retrouvent aspirés par l’agrandissement au détriment de l’installation. On risquerait alors d’assister à la constitution de fiefs inexpugnables, qui colorerait de façon radicalement différente le paysage. Question du jour : « Vaut-il mieux avoir un voisin ou s’agrandir ? ». C’est pour cela qu’au plan national comme dans les régions, l’installation fait plus que jamais office de cheval de bataille, même si certains ne sont pas sans dénoncer le côté un peu « Dr Jekyl et Mister Hyde » du discours agricole sur le sujet. Les jeunes agriculteurs des CDJA 16 et 17 parlent de l’acte « citoyen » qui consisterait à transmettre à un jeune plutôt qu’au plus offrant. Ils n’ignorent rien du caractère peu incitatif du fermage ni de la location « qui conduit à la vente ». S’inspirant des réflexions du CNJA, ils se demandent si des réserves foncières ne pourraient pas voir le jour sous l’égide de collectivités locales, telles les communautés de communes. Même tonalité chez le président du syndicat viticole de la Confédération paysanne 17, Bernard Bégaud qui, comme il existe des ateliers relais ou des magasins relais, propose la création d’exploitations relais. « A l’heure de la retraite, il paraît légitime que les gens puissent vendre leurs vignes pour retrouver un peu de “bonheur économique”. Ne pourrait-on pas créer un organisme du type “conservatoire du territoire” qui achèterait le capital foncier et louerait cet outil de travail aux jeunes ? » Lui aussi stigmatise « le double langage » autour de l’installation. « Il n’y a pas de volonté politique pour permettre aux jeunes de s’installer dans le cadre du fermage. »
Les installations hors cadre familial
En tant que participant aux PIDIL – Programmes pour l’installation et le développement des initiatives locales – lancés en 1995 dans le sillage de la charte nationale pour l’installation en agriculture, les ADASEA réfléchissent à la manière de favoriser les installations hors cadre familial. Des installations qui ne peuvent bien souvent s’envisager que sous forme sociétaire et par le biais du fermage. La vérité commande de dire que ces installations sont très difficiles et n’existent donc pratiquement pas, compte tenu des capitaux en jeu, du problème des garanties à fournir à la banque, du faible attrait de la location et de la préférence des propriétaires à réaliser le patrimoine à la valeur de marché (vente) plutôt qu’à sa valeur économique (fermage). Qui plus est, cette attirance des propriétaires pour la réalisation de leur patrimoine rencontre objectivement celle d’exploitants soucieux de s’agrandir en pleine propriété. « Entre s’agrandir et investir dans un outil de travail plus performant, les gens optent souvent pour l’agrandissement » note un observateur de la chose agricole. Pourtant Philippe Chatellier perçoit des facteurs de changement. Ne commence-t-on pas à voir des difficultés de reprises de grosses exploitations céréalières de 4 à 500 ha.
Le phénomène se rencontre aussi en viticulture où de « belles structures » de 30 ou 40 ha ont du mal à trouver preneur. Dans le secteur laitier, qui fait souvent office de laboratoire des relations sociales, les associations entre tiers ont tendance à se multiplier. Outre l’aspect de la captation des quotas laitiers, l’association hors cadre familial répond à des questions de disponibilité, de main-d’œuvre qualifiée. Entre salariés ou associés, la seconde option prime souvent. Certes, il s’agit d’un challenge. Les structures sociétales réclament de trouver en permanence un équilibre entre associés, entre tâche de direction, de vente, de production… mais c’est aussi un facteur de stabilité et de meilleure réalisation personnelle. De plus en plus, la qualité de vie s’affirme comme un enjeu structurel.