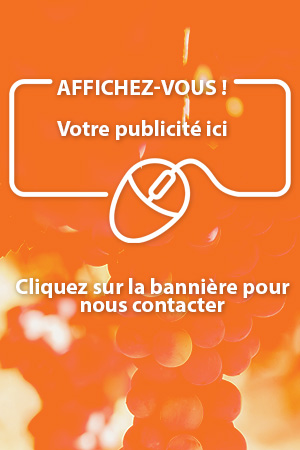Le Paysan Vigneron » – Qu’inspirent les droits de plantation au vignoble de Champagne ?
Le Paysan Vigneron » – Qu’inspirent les droits de plantation au vignoble de Champagne ?
Pascal Ferat – Nous y sommes très attachés en tan t qu’outil de régulation. Le système nous va très bien à condition d’être géré par les viticulteurs et d’être encadrés régionalement par des tableaux de bord économiques qui ne soient pas virtuels mais factuels. La Champagne a toujours été gérée de cette façon et, clairement, il s’agit d’un exemple de progression, tant en terme de chiffre d’affaires que de nombre d’opérateurs. Les droits de plantation n’ont jamais bridé le développement de l’économie champe- noise. Grâce à une gestion très saine, très précise du potentiel de production par rapport aux débouchés, nous avons pu augmenter le vignoble de 10 000 ha en 20 ans, sans générer de surcharge. Au contraire, nous avons créé de la richesse.
« L.P.V. » – Comme alternative aux droits de plantation, les négociants en vin mettent en avant les interprofessions.
P.F. – Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d’accord avec mes amis et partenaires du négoce. Si l’on prend le seul exemple du vignoble français, aucune interprofession fonctionne de la même manière, possède le même périmètre. En Champagne – comme à Cognac peut-être – c’est très simple, très facile. Nous n’avons qu’une AOC, pas de vins sans IG. Mais il s’agit d’un cas particulier, pas extensible à l’infini. Ainsi, faire des interprofessions la réponse univoque à la disparition des droits de plantation me semble un raccourci assez dangereux. Je pense qu’il est motivé par l’absolue volonté du négoce d’être pilote du système.
« L.P.V. » – Et ça vous gêne ?
P.F. – En fait, pour piloter, une double vision s’impose, de l’amont et de l’aval. Le négoce, de manière organique, pilote en regardant l’aval, c’està- dire le marché. A ce titre, il peut être amené à anticiper une évolution commerciale qui ne se concrétisera pas. Pourtant, elle se répercutera sur l’amont. Le vignoble supportera alors le risque, avec les conséquences que ces mauvaises prévisions peuvent entraîner. A l’inverse, par sa construction même, le vignoble est conduit à enraciner ses décisions sur le long terme. Cette caractéristique lui intime l’obligation de nourrir à la fois la vision amont et la vision aval. C’est un gage de gestion sereine.
« L.P.V. » – Concrètement, comment voyez-vous les choses ?
P.F. – En Champagne, les questions de production sont toujours restées entre les mains du vignoble. Par contre, la répartition de l’enveloppe s’effectue au niveau interprofessionnel. Demain, si un programme de plantation se dessine, la décision reviendra au vignoble. La répartition des 200 ou 300 ha des droits de plantations se discutera au sein de l’interprofession, pour satisfaire les besoins de chacun. Mais, je le répète, la gestion du vignoble incombe aux vignerons.