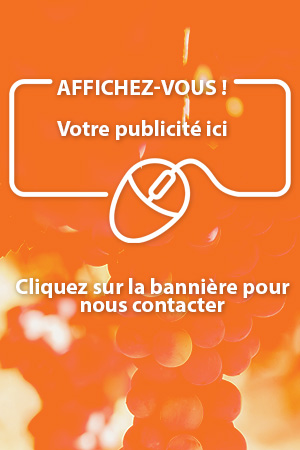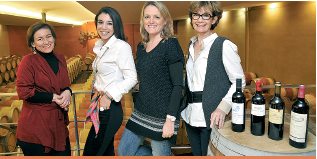 Ce n’est pas de la vantardise mais un constat sans fausse modestie. Le cabinet PwC et les caisses de Crédit Agricole se décrivent comme « des acteurs solides, présents sur l’ensemble de la filière ». « Notre valeur ajoutée, disent-ils, c’est de porter un regard un peu différent sur la filière, car nous sommes au cœur même des informations les plus détaillées. » Sur la zone délimitée, le Crédit Agricole affiche un encours Cognac d’un milliard d’euros pour l’ensemble des deux Caisses régionales 16 et 17. « Nous sommes de loin le premier banquier du Cognac en terme de fonds engagés. Nous endossons la responsabilité de banquier de territoire. »
Ce n’est pas de la vantardise mais un constat sans fausse modestie. Le cabinet PwC et les caisses de Crédit Agricole se décrivent comme « des acteurs solides, présents sur l’ensemble de la filière ». « Notre valeur ajoutée, disent-ils, c’est de porter un regard un peu différent sur la filière, car nous sommes au cœur même des informations les plus détaillées. » Sur la zone délimitée, le Crédit Agricole affiche un encours Cognac d’un milliard d’euros pour l’ensemble des deux Caisses régionales 16 et 17. « Nous sommes de loin le premier banquier du Cognac en terme de fonds engagés. Nous endossons la responsabilité de banquier de territoire. »
De par sa structure, le cabinet de comptabilité et d’audit PwC est présent sur l’ensemble des métiers du Cognac, de la viticulture au négoce en passant par les marchands en gros, bouilleurs de profession, coopératives associées, organismes de stockage. Les deux confirment une conjoncture porteuse. « La filière va bien dans son ensemble, va même très bien » note Antoine Mornaud, directeur des clientèles spécialisées au Crédit Agricole Charente-Périgord. Même appréciation de Jean-Marc Olivier, présenté non sans humour par Jean-Marie Ordonneau, du cabinet PwC, comme « notre grand sachant ».
Un cycle très positif
A travers son « baromètre du Cognac », l’ancien P-DG de la maison Courvoisier estime que la situation a rarement été aussi bonne. « Depuis 2001, les ventes de Cognac n’ont cessé d’augmenter. Elles ont crû de 27 % en volume et de plus de 60 % en chiffre d’affaires (2,3 milliards € en 2012) après avoir connu leur niveau le plus bas à la fin de la décennie 1990 (368 000 hl AP, un milliard d’€ de chiffre d’affaires). » Le plus surprenant, c’est que « l’exceptionnel dure » s’étonne presque l’ancien chef de maison. « Nous sommes à coup sûr dans un cycle très positif, même s’il faut garder en tête que certains accidents climatiques, certains accidents de marchés peuvent toujours survenir. »
Ce bon « trend » ne signifie pas que la région n’ait pas de défis à relever. Bien au contraire. « Les évolutions sont en marche, il faut s’y adapter. » « Le « mix-produit » a bougé assez vite depuis quelques années » relève J.-M. Olivier. Il fait bien sûr allusion à la premiumisation des ventes, en n’oubliant pas de signaler qu’aucun marché ne doit être négligé. « Chez les jeunes d’aujourd’hui, le marché du VS prépare les ventes de VSOP et d’XO de demain. »
Face à des qualités vieilles qui ont le vent en poupe, l’équilibre des stocks devient une composante hautement stratégique. Et difficile à résoudre. Pour une raison simple, rappelée par J.-M. Olivier : « Dès que vous vendez une bouteille supplémentaire d’XO par an, il vous en faut 15 de plus en stock (une dizaine d’années de vieillissement + l’évaporation). Par contre, si vous en vendez une de moins par an, il y en a 15 en trop. » Le fameux effet ciseau, redoutable à Cognac.
L’anticipation des besoins futurs
Depuis 2006, la région produit davantage que ses besoins de l’année. La justification de cette mise en stock ! C’est l’anticipation des besoins futurs. Car les projections régionales « maisons » donnent des besoins en nette augmentation. Un argument clé soutient ces projections : le constat que les spiritueux dits « internationaux » – par comparaison aux spiritueux locaux chinois, brésiliens… – augmentent partout dans le monde « et que le Cognac, dans tout ça, représente une goutte d’eau ». Preuves à l’appui, présentées par J.-M. Olivier : « Au début des années 2000, dans le monde, le marché des spiritueux importés pesait pour 310 millions de caisses. Aujourd’hui, il représente 410 millions de caisses. Avec 11 millions de caisses, la part du Cognac ne dépasse pas 2,5 % de l’ensemble. En volume, le Cognac représente 8 fois moins que le Whisky ou la Vodka, 4 fois moins que le Rhum ou les liqueurs. » Ces chiffres distillent un message : celui de la marge de progression confortable dont jouit le Cognac, qui lui ouvrirait une série d’opportunités.
« Un changement de modèle »
Jean-Marie Ordonneau, associé de PwC, parle d’un « changement de modèle ». « C’est un modèle gagnant/gagnant, dit-il, symbolisé par l’effort important du négoce sur les prix des vins et des eaux-de-vie, pour un meilleur partage de la valeur ajoutée. »
Le cabinet PwC suit depuis 20 ans un échantillon de 250 exploitations, portant sur 8 000 ha de vignes, tous crus et toutes tailles d’exploitation confondus. En viticulture, le pic du chiffre d’affaires a été atteint en 2006-2007, suites à des ventes exceptionnelles d’eaux-de-vie rassises. Le chiffre d’affaires/ha avait alors grimpé à plus de 10 000 € l’ha sur l’échantillon. Aujourd’hui, il s’est stabilisé autour de 9 000-9 500 € de l’ha. « Le plus important, souligne l’expert-comptable, c’est le résultat net, d’environ 3 000 € l’ha soit, par rapport au chiffre d’affaires, 30 % de revenu net. » Commentaires du même : « Actuellement, beaucoup de secteurs d’activité se satisferaient de ce ratio. »