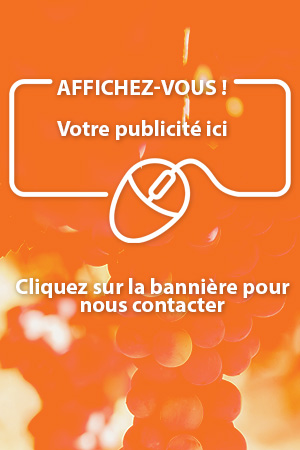Le 2 septembre dernier, deux contrôleurs du travail en agriculture, l’un de la MSA, l’autre de l’inspection du travail, tombaient sous les coups de feu d’un agriculteur de Dordogne, assassinés à bout portant. A notre demande, Alain Gaillard, chef de service de l’ITEPSA de la Charente, revient sur cette affaire, en précisant les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle du travail en agriculture.
Rappel des faits
Syvie Trémouille était contrôleur stagiaire à l’Inspection du travail en agriculture, Daniel Buffière inspecteur à la Mutualité sociale agricole de Périgueux, chef du service contrôle. Ils étaient respectivement âgés de 40 et 47 ans. Le jeudi 2 septembre, entre 16 heures et 16 H 30, ils ont été abattus par une arme à feu, tirée à bout portant dans l’abdomen de Daniel Buffière et dans le dos de Sylvie Trémouille alors qu’elle tentait de s’enfuir. Le meutrier, Claude Daviau, a retourné l’arme contre lui mais ne s’est blessé qu’à la mâchoire. Sylvie Trémouille est morte sur le coup, son collègue dans la nuit qui a suivi. A Saussignac, à l’ouest de Bergerac, sur la rive gauche de la Dordogne, l’exploitation de Cl. Daviau se consacre à la prune et à la vigne. Les deux agents intervenaient dans le cadre d’un contrôle des contrats de travail des saisonniers. Après avoir discuté avec les contrôleurs une quinzaine de minutes en s’emportant, Claude Daviau est reparti chez lui prendre un fusil et a tiré.
« Le Paysan Vigneron » – Quelle fut votre réaction et celle de vos collègues à l’annonce de ce double meurtre ?


« L.P.V. » – Combien de procès-verbaux dressez-vous dans l’année ?
A.G. – Si je prends la dernière période de cinq ans, je crois que nous avons dressé vingt-cinq procès-verbaux, ce qui donne une moyenne de cinq procès-verbaux par an. Dans ces conditions, qu’on ne nous dise pas que nous sommes répressifs !
« L.P.V. » – Vous touchez combien d’entreprises ?
A.G. – Le département de la Charente compte 2 400 entreprises employeuses de main-d’œuvre rattachées au régime agricole. Contrairement à ce que l’on pense souvent, ce chiffre ne recouvre pas les seules exploitations agricoles. Il intègre aussi tout le secteur forestier, les scieries, les entreprises de travaux agricoles, le secteur des coopératives céréalières, laitières, viticoles, les jardineries, les pépinières, le secteur tertiaire (assurances agricoles, mutualité…), les artisans ruraux, au nombre de 172. En tout, ces entreprises emploient près de 10 000 salariés, dont 2 130 dans le secteur tertiaire et 622 dans les entreprises artisanales. Plus de 50 conventions collectives s’appliquent sur ces secteurs.
« L.P.V. » – C’est le service départemental de l’ITEPSA qui est chargé du contrôle ?
A.G. – Le contrôle des lois issues du droit du travail (35 heures, durée du travail, hygiène et sécurité…) fait en effet partie de nos missions, à côté de la promotion de l’emploi et de la protection sociale agricole. Le service compte trois agents, un inspecteur – votre serviteur – et deux contrôleurs. A noter que la moitié des communications téléphoniques du service concernent des demandes de renseignements de la part des entreprises. La MSA dispose également d’un service de contrôle. Sur les aspects de déclaration du travail, nous sommes amenés à faire des sorties communes avec les inspecteurs de la MSA.
« L.P.V. » – Comment se déroule une procédure de contrôle ?
A.G. – Elle débute toujours par un contact verbal avec l’entreprise. On pose des questions, on discute avec l’employeur, éventuellement avec les salariés s’ils sont présents, en sachant que le chef d’entreprise est notre interlocuteur privilégié. L’entrevue peut donner lieu à observations. Parmi ces observations, je citerais de « grands classiques », comme la non-remise de bulletins de salaires, la non-déclaration de salariés, y compris les occasionnels ou les saisonniers, le non-suivi des consignes d’hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne les matières dites dangereuses… Il s’agit-là de « fondamentaux » sur lesquels nous ne pouvons pas transiger. Ces observations sont confirmées par écrit. Nous ne dressons jamais de procès-verbaux « sur le tas ». Nous demandons par courrier à l’employeur « de nous tenir informés des suites qu’il entend réserver à notre visite ». Il a un mois pour le faire. A défaut de réponse dans le délai imparti, nous lui adressons une lettre de rappel et si, vraiment, aucun compte n’est tenu de notre visite, si l’employeur manifeste de la mauvaise volonté, c’est là qu’un procès-verbal peut être dressé, à défaut de pouvoir faire avancer autrement le dossier. Ceci étant, nous veillons toujours à appréhender la situation globale de l’entreprise, en tenant compte de ses difficultés économiques.
« L.P.V. » – Quel sort est réservé au procès-verbal ?
A.G. – Le procès-verbal est transmis au tribunal qui fixe le montant de la pénalité. A titre d’exemple, un délit de travail dissimulé assorti d’une obstruction à fonctionnaire, la personne n’ayant pas voulu nous transmettre les éléments demandés, a été puni d’une amende de 1 000 € par le magistrat. Ceci étant, il ne convient pas de mettre un trop grand éclairage sur le procès-verbal. Je vous rappelle que face aux 2 400 entreprises de notre ressort, nous n’avons dressé que cinq procès-verbaux par an, un chiffre ridiculement bas. Je n’imagine pas un gendarme ne dressant que cinq procès-verbaux par an !
« L.P.V. » – Etes-vous agents assermentés ?
A.G. – En effet nous sommes agents assermentés et, à ce titre, nous détenons une carte professionnelle. Mais contrairement aux gendarmes qui jouissent d’une compétence générale pour constater les faits, du Droit du travail en passant par les infractions routières, notre compétence se borne à notre seul domaine d’activité, le Droit du travail.
« L.P.V. » – Sur quels critères se déclenchent les contrôles ?
A.G. – Il y a tout d’abord la voie des contrôles systématiques. A partir du fichier des entreprises que nous possédons ici, on peut décider de rencontrer, sur une commune, une semaine donnée, un horticulteur, un artisan, un viticulteur et le même échantillon dans une autre commune la semaine suivante. Des contrôles peuvent aussi être effectués après signalement, par un salarié, de manquements significatifs, relatifs, par exemple, au non-paiement d’heures supplémentaires ou d’absence de congés payés. Je dois dire que ce courant a tendance à se tarir, peut-être du fait de l’efficacité des contrôles systématiques.
« L.P.V. » – Y a-t-il plus de contrôles aujourd’hui qu’hier ?
A.G. – Les contrôleurs de l’agriculture sont peut-être plus présents sur le terrain mais ceci s’explique par notre héritage. Dans le passé, il n’existait pas de section agricole prud’homale. Pendant 30 ans, nos services ont participé au règlement de litiges individuels. Depuis que cette anomalie a été réparée et même s’il nous arrive encore de réaliser, à la demande des parties, le règlement de litiges individuels, nos ratios de contrôles ont rattrapé ceux de nos collègues du régime général. D’où cette impression, parfois, de subir plus de contrôles.
« L.P.V. » – Prévenez-vous de votre passage ?
A.G. – Les deux cas de figure se rencontrent. Parfois, nous pouvons prévenir pour être sûr de trouver la personne ou pas.
« L.P.V. » – Avez-vous identifié dans votre fichier des entreprises à risque, chez lesquelles la mission de contrôle peut mal se terminer ?
A.G. – Disons qu’il y a une vingtaine d’entreprises sur les 2 400 où nous savons la personne potentiellement violente. Je précise qu’en Dordogne, l’exploitant en question n’était pas repéré comme tel. On a parlé d’une dépression mais, contrairement à ce que l’on a bien voulu dire, il ne semble pas qu’il ait eu de problème économique particulier. Cela signifie que ce type de réactions est imprévisible, ce qui nous interpelle beaucoup. Par ailleurs, les deux contrôleurs en question étaient connus comme des gens qui cherchaient à trouver une solution. Ils étaient très impliqués dans la vie de leur région et n’avaient pas un comportement très zélé en matière de sanction. Ils intervenaient dans le cadre d’une mission presque banale. Que des contrôleurs se rendent sur une exploitation pour essayer de savoir si les salariés saisonniers qui y travaillent sont en règle ne relève pas d’un grand particularisme. C’est tout ce qu’il y a de plus ordinaire.
« L.P.V. » – Est-ce que le drame de Saussignac va changer votre façon de travailler ?
A.G. – Nous avons prévu de mieux identifier un certain nombre d’entreprises. C’est déjà fait mais le dispositif va être complété en croisant des fichiers avec d’autres administrations. Par ailleurs, le corps des inspecteurs du travail s’est réuni le 24 septembre dernier pour aborder le problème spécifique du contrôle et de la méthodologie de ce contrôle. Nous demandons l’assistance de psychologues pour être formés à la gestion des situations de crise. Le but n’est pas de « faire monter la mayonnaise ».
« L.P.V. » – Diriez-vous que vous exercez un métier à risque ?
A.G. – A l’évidence, ce n’est pas une profession à risque zéro. Par contre je suis persuadé qu’il y a des choses à faire pour limiter ce risque, par la formation au contrôle mais aussi en développant l’aspect pédagogique auprès des entreprises. Ici en Charente nous n’avons pas changé notre façon de travailler, les visites continuent comme avant, même si une réflexion est en cours. Malgré ce qui s’est passé, je ne pense pas qu’il y ait une spécificité de violence de la population agricole par rapport aux autres corporations. Cela fera bientôt 30 ans que je suis au contact de l’agriculture. J’ai eu à gérer des situations difficiles, tendues mais on retrouve les mêmes dans le régime général, tout en sachant, comme les médias l’ont dit, que se développent les « délits d’obstacles, d’outrages et d’agressions verbales et physiques ». C’est un phénomène national. Je voudrais ajouter qu’à mon avis rien ne peut justifier que l’on tire sur quelqu’un. C’est pour cela que certaines phrases m’ont semblé déplacées, voire même friser l’indécence. Lire sous la signature de certains syndicats et organismes agricoles qu’il était « prévisible que quelqu’un se livre à cet acte insensé » ou que l’agriculture évoluait « vers une sur-administration », plongeant les agriculteurs « dans un état d’incertitude et d’insécurité » sont des arguments qui peuvent être perçus comme autant de justifications. Or rien ne peut justifier un tel drame. Quand je vois tenir de tels propos, pour le dire familièrement, « il y a un bout de l’artichaut qui passe mal ».