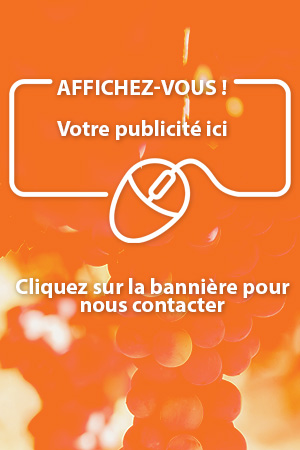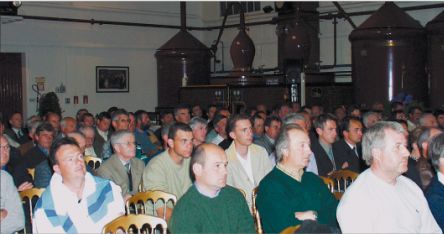
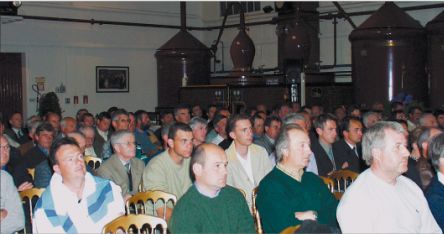
La sica UVPC traverse, depuis maintenant deux ans, la période la plus difficile de son histoire puisque les entrées d’eaux-de-vie nouvelles de 12 600 hl d’AP en 2000 sont passées à 6 615 hl d’AP en 2001 et 3 300 hl d’AP en 2002. Une telle diminution des achats a bouleversé les équilibres économiques des 190 adhérents de la coopérative qui, pour la plupart, s’interrogent sur l’avenir de leurs engagements commerciaux avec la maison de négoce. La forte participation à cette réunion atteste à la fois de la qualité des relations humaines entre l’équipe du service production et les viticulteurs, et aussi des attentes en matière d’informations sur l’avenir de Martell. Le président, M. Bernard Laurichesse, a ouvert les débats de cette assemblée générale dans une ambiance qui ne se prêtait pas particulièrement à l’optimisme. Dans son intervention, il a commenté les grands événements techniques et professionnels durant la dernière campagne et fait état du contexte économique de plus en plus précaire auxquels sont confrontés les viticulteurs.
Un cycle végétatif marqué par des séquences climatiques très contrastées
Le cycle végétatif 2002 a été marqué par une série de séquences climatiques contrastées qui ont eu des incidences significatives sur les caractéristiques de la récolte. L’hiver 2001-2002 particulièrement doux et précoce a conduit à un débourrement précoce et assez régulier qui laissait apparaître un nombre d’inflorescences assez élevé. La dernière décade de mai et les premiers jours de juin pluvieux et surtout froid ont perturbé la floraison des cépages précoces (de la coulure sur les Merlot, les Gamay, les Sauvignon et les Chardonnay) mais pas celle des Ugni blanc qui ont profité d’une belle période pour fleurir. A partir de la fin juillet et durant tout le mois d’août, le climat a été pluvieux et déficitaire en chaleur et en ensoleillement, ce qui a gêné considérablement le début de la maturation. Début septembre, la présence de nombreux foyers de botrytis et un net retard de la maturation constituaient des sujets d’inquiétudes majeurs vis-à-vis de la qualité de la future récolte. Heureusement, un climat sec et particulièrement ensoleillé s’est installé du 10 septembre jusqu’à la fin octobre et les raisins en ont tiré le meilleur profit. Les vendanges se sont déroulées dans le courant du mois d’octobre et une belle récolte a été rentrée dans les chais sur le plan qualitatif. Les foyers de botrytis avaient séché et disparu, les acidités (surtout les teneurs en acide malique) sont restées à des niveaux élevés et les rendements se sont aussi nettement contractés. La récolte de vins blancs Cognac est moyenne (8 578 712 hl) et légèrement supérieure à celle de 2001. Les caractéristiques organoleptiques et analytiques des vins de distillation du millésime 2002 étaient au final très satisfaisantes pour élaborer des eaux-de-vie aromatiques.
La segmentation des filières de production, une idée qui fait son chemin
Sur le plan professionnel, la dernière campagne s’est déroulée avec une organisation assez proche de la précédente. Une QNV Cognac de 6 hl d’AP/ha (modulable par 1,75, soit un plafond de 105 hl/ha), un rendement agronomique maintenu à 120 hl/ha, les moûts destinés à la concentration inclus dans la QNV, une déclaration d’affectation de la QNV remise avec la déclaration ont constitué les grandes lignes de l’organisation de campagne. Une distillation d’alcool de bouche art. 29 a été déclenchée entre le 1er octobre et le 30 décembre. Les arrachages définitifs ont concerné des surfaces plus importantes (1 658 ha) dont le financement complémentaire sera assuré à parts égales par l’Etat, la région et la viticulture. B. Laurichesse a aussi fait état des difficultés croissantes que rencontrent bon nombre d’exploitations dans la région, suite à une perte de chiffre d’affaires de 44 % en moyenne depuis 1992 (et de 15 % depuis 2000). Les équilibres financiers des viticulteurs continuent de se dégrader ces dernières années au point que les structures fondamentales de l’outil de production ne sont plus entretenues et renouvelées. Cette situation n’aura d’issue qu’en agissant sur la surcapacité potentielle de production et, par ailleurs, les discussions sur la montée de la QNV Cognac et la revalorisation du prix de l’hl d’AP doivent être abordées avec sérénité et en pleine transparence. Sur le plan interprofessionnel, les réflexions au sein du groupe stratégie 2010 sont allées bon train au cours de l’année 2002 et un schéma d’avenir du vignoble des Charentes. Ce projet, critiquable ou non, a le mérite d’exister et d’apporter une solution à la suppression du système double fin et aux viticulteurs qui se sont engagés dans le plan d’adaptation. L’objectif serait d’identifier et de séparer le vignoble en quatre filières distinctes : l’une destinée à la production de Cognac, la seconde spécifique au Pineau, la troisième réservée à la production de vins de table et de vins de pays, et une quatrième spécialisée pour la production de vins industriels. Des cahiers des charges de production propres à chaque vignoble seraient définis et cette organisation s’appuierait sur un régime d’affectation parcellaire. Le renforcement des conditions de production du Cognac est envisagé dans le cadre du décret INAO, et d’ailleurs le comité régional du mois de février a entériné le
décret.
Des expéditions en progression de 6,7 % en 2002
Au cours de l’année 2002, les sorties de Cognac ont progressé de 6,7 % et atteignent le niveau de 405 000 hl d’AP, ce qui constitue une bonne nouvelle pour l’économie régionale. Les expéditions de Cognac ont atteint le niveau de 343 755 hl d’AP, mais cette progression des ventes varie selon les qualités commerciales.
 Les Cognacs VS, qui représentent 56,2 % des expéditions totales, progressent de + 4 %, les VSOP (34 % du total) augmentent plus fortement de 6,3 % et les qualités supérieures (9,8 % du total) enregistrent une hausse encore plus significative de 15 %. Le marché américain absorbe 35 % des volumes, l’Europe reste stable et le continent asiatique a progressé de 6 % (malgré une nouvelle chute du marché japonais). Les ventes en France ont connu une progression de 7,2 % et retrouvent leurs niveaux de l’année 2000. M. B. Laurichesse s’est félicité de ce bilan commercial 2002 très positif tout en faisant remarquer que le spectaculaire développement commercial du Cognac aux États-Unis depuis dix ans pouvait être un point de fragilité pour l’économie régionale. Ses derniers propos sur le sujet traduisaient sûrement les craintes de beaucoup de viticulteurs dans la région : « Néanmoins, l’importance volumique actuelle de ce marché avec plus de 110 000 hl d’AP et 35 % des expéditions totales est à la fois porteuse d’espoir et de fragilité. Nous devons nous réjouir de l’intérêt porté par les Américains pour le Cognac, mais qu’adviendrait-il de la région si ce pays venait à boycotter notre produit ? Par ailleurs, le ralentissement de la croissance économique dans le monde et en Europe est une inquiétude de pleine actualité car les périodes de difficultés économiques entraînent, en général, un ralentissement de la consommation des produits de luxe. » Le président a terminé son intervention en expliquant que la diminution des achats de 50 % a eu et aura des conséquences économiques graves sur les entreprises viticoles mais, néanmoins, la sica continue de jouer son rôle malgré les petites livraisons d’un certain nombre d’adhérents. Aucun livreur de l’UVPC n’a été écarté par la maison Martell même pour de petits volumes, mais l’effort consenti par les viticulteurs est considérable. M. B. Laurichesse a aussi souhaité que les dirigeants de Martell présents lors de l’assemblée générale apportent aux adhérents des informations sur l’activité commerciale de l’entreprise en 2002 et les perspectives pour 2003 et précise les intentions d’achat pour les récoltes à venir en volume et en prix. Au sein de la sica, un changement de lieu de stockage est intervenu au cours de l’année 2002. Les eaux-de-vie étaient stockées dans les chais de Saint-Martin, mais l’ampleur des investissements nécessaires à la mise en conformité des bâtiments a contraint la société Martell et le conseil d’administration à envisager à moyen terme la fermeture de ce site. Le stockage des eaux-de-vie de la récolte 2002 a été confié au magasin général ORECO, après s’être assuré que les frais inhérents à cette prestation seraient équivalents à ceux définis par le règlement intérieur de la coopérative.
Les Cognacs VS, qui représentent 56,2 % des expéditions totales, progressent de + 4 %, les VSOP (34 % du total) augmentent plus fortement de 6,3 % et les qualités supérieures (9,8 % du total) enregistrent une hausse encore plus significative de 15 %. Le marché américain absorbe 35 % des volumes, l’Europe reste stable et le continent asiatique a progressé de 6 % (malgré une nouvelle chute du marché japonais). Les ventes en France ont connu une progression de 7,2 % et retrouvent leurs niveaux de l’année 2000. M. B. Laurichesse s’est félicité de ce bilan commercial 2002 très positif tout en faisant remarquer que le spectaculaire développement commercial du Cognac aux États-Unis depuis dix ans pouvait être un point de fragilité pour l’économie régionale. Ses derniers propos sur le sujet traduisaient sûrement les craintes de beaucoup de viticulteurs dans la région : « Néanmoins, l’importance volumique actuelle de ce marché avec plus de 110 000 hl d’AP et 35 % des expéditions totales est à la fois porteuse d’espoir et de fragilité. Nous devons nous réjouir de l’intérêt porté par les Américains pour le Cognac, mais qu’adviendrait-il de la région si ce pays venait à boycotter notre produit ? Par ailleurs, le ralentissement de la croissance économique dans le monde et en Europe est une inquiétude de pleine actualité car les périodes de difficultés économiques entraînent, en général, un ralentissement de la consommation des produits de luxe. » Le président a terminé son intervention en expliquant que la diminution des achats de 50 % a eu et aura des conséquences économiques graves sur les entreprises viticoles mais, néanmoins, la sica continue de jouer son rôle malgré les petites livraisons d’un certain nombre d’adhérents. Aucun livreur de l’UVPC n’a été écarté par la maison Martell même pour de petits volumes, mais l’effort consenti par les viticulteurs est considérable. M. B. Laurichesse a aussi souhaité que les dirigeants de Martell présents lors de l’assemblée générale apportent aux adhérents des informations sur l’activité commerciale de l’entreprise en 2002 et les perspectives pour 2003 et précise les intentions d’achat pour les récoltes à venir en volume et en prix. Au sein de la sica, un changement de lieu de stockage est intervenu au cours de l’année 2002. Les eaux-de-vie étaient stockées dans les chais de Saint-Martin, mais l’ampleur des investissements nécessaires à la mise en conformité des bâtiments a contraint la société Martell et le conseil d’administration à envisager à moyen terme la fermeture de ce site. Le stockage des eaux-de-vie de la récolte 2002 a été confié au magasin général ORECO, après s’être assuré que les frais inhérents à cette prestation seraient équivalents à ceux définis par le règlement intérieur de la coopérative.
Les eaux-de-vie de 2002 sont à classer dans le registre des bons millésimes


Les travaux de la Station Viticole du BNIC ont permis de connaître l’origine de quelques accidents analytiques (seulement 3 % des échantillons dans la région) qui avaient conduit à des productions anormalement élevées d’acétate d’éthyle alors que, organoleptiquement, le défaut n’était pas présent. Dans un premier temps, les soupçons s’étaient portés sur un lot de levure FC9, mais les résultats des études disculpent cette levure sélectionnée. Il s’avère que la production directe d’acétate d’éthyle est liée à une espèce de levure indigène non Cerevisae qui s’est développée de manière exceptionnelle avant la colonisation du milieu par les apports de souches sélectionnées. D’une manière générale, les teneurs en acétate d’éthyle (sans atteindre les seuils extériorisant une déviation aromatique) et en esters aromatiques totaux des vins de la récolte 2002 étaient naturellement un peu plus élevées que celles des années passées. Ce phénomène constitue un effet millésime qui s’est révélé bénéfique vis-à-vis de la structure aromatique des eaux-de-vie. Enfin, M. P. Raguenaud a abordé brièvement la démarche HACCP mise en œuvre par l’entreprise depuis plusieurs années. La recherche des points critiques en matière de sécurité alimentaire au niveau de l’ensemble de la filière de production Cognac avait amené ces dernières années à intégrer de nouveaux éléments dans le règlement intérieur de la sica. Il avait été notamment demandé aux viticulteurs, d’une part de respecter les préconisations régionales de la Station Viticole du BNIC en matière d’utilisation des produits de traitement (en terme de choix de produits comme de date d’application) et, d’autre part, d’être en mesure de fournir le calendrier de traitements réellement mis en œuvre sur leurs exploitations (en justifiant de l’achat des spécialités commerciales). Dans l’avenir, la maison de négoce souhaite que les bouilleurs de cru s’équipent de tuyaux souples conformes au transfert des eaux-de-vie. Une expérimentation réalisée par la Station Viticole du BNIC a permis de tester la plupart des flexibles utilisés lors du pompage des eaux-de-vie et il s’avère que seulement deux ou trois produits commerciaux sont parfaitement inertes vis-à-vis des risques de relargage de résidus.
Un discours optimiste sur l’avenir de Martell
L’intervention du directeur général de Martell & Co, M. Lionel Breton, a été le moment fort de cette réunion et il est évident que la présence d’un public de viticulteurs aussi nombreux traduisait une véritable attente en matière d’information sur l’activité de Martell presque deux ans après la reprise de la société par le groupe Pernod-Ricard. Par ailleurs, les récents événements sociaux au sein de l’entreprise ont peut-être aussi contribué à entretenir un climat d’incertitude sur la volonté de relancer la marque qui avait été clairement exprimée lors de la dernière assemblée générale de la sica. La teneur du discours de M. Lionel Breton a été résolument optimiste à la fois au niveau de la réorganisation stratégique de l’entreprise, des commentaires sur l’activité de Martell en 2002 et sur les perspectives commerciales dans l’avenir. Le directeur général a réaffirmé à la tribune que l’une des priorités du groupe Pernod-Ricard était de relancer Martell avec l’objectif à terme « de faire des caisses et toujours plus de caisses ». Martell, qui était devenu sous l’ère Seagream un centre de production, a vu ses structures profondément évoluer puisque le pôle Cognac est redevenu une entreprise à part entière propriétaire de sa marque. Un service marketing et une équipe commerciale spécifiques à Martell ont été créés pour assurer la redynamisation de la marque auprès de l’ensemble des filiales de distribution du groupe Pernod-Rcicard dans le monde. Des démarches stratégiques de fond ont été mises en œuvre depuis le début de l’année 2002 pour « travailler la marque », et l’interview de M. L. Breton atteste de ce changement de cap qui, souhaitons-le, se concrétise par des volumes en hausse significative des ventes. Par contre, au niveau des volumes d’achats d’eaux-de-vie et de vins de distillation, aucune bonne nouvelle n’a été annoncée pour la prochaine campagne. Le directeur général de Martell a tenu un langage de vérité sur ce sujet en indiquant que, pour l’instant, l’entreprise continuait sa politique de déstockage et que l’ouverture « du robinet des achats » est directement conditionnée par le développement des ventes. La réaction des viticulteurs à l’ensemble de ces propos a été à la fois attentive pour le moyen terme et très prudente par rapport aux réalités économiques du moment et aux niveaux d’achats de Martell. A l’issue de la réunion, les nombreux échanges entre les bouilleurs de cru et les différents responsables du service de production attestaient de la qualité des relations humaines au sein de la sica UVPC sans pour autant occulter la réalité du moment : « Des niveaux d’achats bas et des niveaux de revenus en chute libre qui fragilisent l’économie des exploitations viticoles ? »